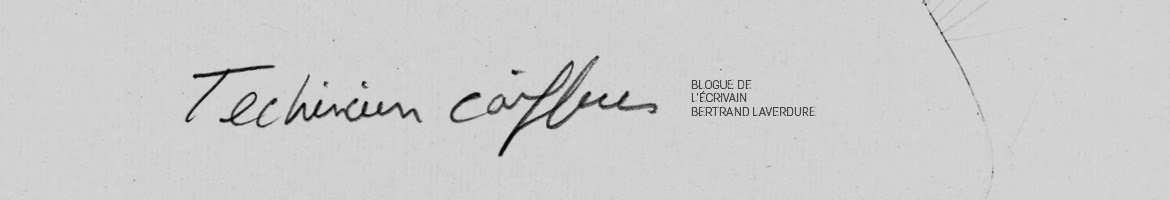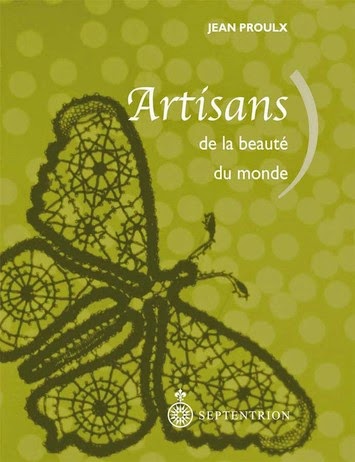Qui ne veut pas laisser une trace ? À tout le moins, un graffiti sur un mur
de béton ou une porte de toilette publique, ou même un simple «I was here» buriné dans l’écorce d’un arbre.
Parmi tous les arts, la littérature donne l’opportunité de laisser une trace
écrite, imprimée, ne serait-ce qu’un titre qui perdurera au catalogue des
livres publiés, à la bibliothèque du congrès, à Washington, aussi bien que dans
une recherche googlienne. Bien entendu, ça ne compte pas. Dans les faits, ça
n’a aucun poids ni importance. Tout le monde sait bien que laisser une trace
c’est perdurer dans l’inconscient collectif, faire l’histoire littéraire,
énerver toute la fratrie des commentateurs et des lecteurs, à la limite publier
un best-seller de haute tenue qui fera date. Laisser une trace dans l’histoire
est toujours beaucoup plus sérieux et demande toujours beaucoup plus de
sacrifice que de littéralement «laisser une trace».
La plupart des gens se contentent d’enfanter, de planter un arbre ou de lever le poing une ou deux fois dans
leur vie, pour défendre un principe ou appuyer une cause qui les mobilise. Mais
les écrivains ne se contentent pas de cette figuration symbolique et
fantomatique. Je n’ai jamais connu aucun écrivain qui n’était pas narcissique,
persuadé de sa valeur. C’est nécessaire parce que la vie littéraire peut être
terne ou déprimante et qu’il faut garder la foi en son talent pour perdurer ne
serait-ce que dans sa propre psyché, ou pour fournir un effort adéquat afin de
produire des œuvres, des livres, qui en valent la peine. De plus, sans cette
psychose partielle du grand talent ou du génie, comment certains auraient
l’odieux de nous infliger leurs galettes ? Pseudo génie rime souvent avec
grande naïveté. Mais sans grand aveuglement, pas de grandes œuvres. C’est le
paradoxe de l’élan littéraire.
Puis il y a des écrivains qui ne jurent que par la littérature, ne vivent
qu’à travers ses mythes et ses symboles, sa religion et sa déconstruction, en
plein village global des morts-vivants des œuvres du passé, en attente d’une
case neuve pour leur effigie.
Mathieu Arsenault fait partie de cette brigade littéraire de combat, qui,
d’une main, décerne des lauriers aux auteurs méritants qui prônent une
esthétique qui lui convient, underground, virulente, dans la lignée d’une
parole crue, sans apprêt, lisible sans dictionnaire et sauvage dans son
inspiration, par l’entremise de son Gala de l’Académie des lettres du vingtième
et unième siècle, et de l’autre, astique le pieu langagier qui lui permettra de
percer l’apathie de l’histoire littéraire.
Tout son agenda consiste à «laisser une trace».
Mathieu Arsenault aurait pu avoir pour slogan «la littérature o la muerte».
Bien qu’il ne soit pas du type sacrificiel ni martyr dans l’âme. Mais
toutefois, il ne veut pas jouer à moitié au jeu du «laissage de trace» en
littérature et c’est pour le mieux pour notre propre apathie naturelle.
Mathieu Arsenault a publié récemment LA VIE LITTÉRAIRE, au Quartanier.
Sortie conjointe avec le deuxième livre, Drama queen, celui-là posthume, de
Vickie Gendreau, sa protégée, son amie, sa Nelligan (lui jouant le rôle de
Louis Dantin ou Eugène Seers dans le scénario tragique de cette vie fulgurante
couvant un talent fulgurant).
Après avoir parlé de frustrations adolescentes, dans Album de finissants
(maintenant en livre de poche) et de sa vie insignifiante dans Vues d’ici, il
s’attaque maintenant à l’intolérable vernie d’une minceur ridicule qui protège
le triste écosystème de la vie littéraire québécoise, de sa vie littéraire, de
la vie en littérature, comme l’on pourrait dire «vivre en religion».
Mathieu Arsenault a un doctorat en littérature. Il est un homme de grande
culture, s’exprime outrageusement
bien en public, sait vulgariser ses postures littéraires, a un peu d’humour et
aime être sur une scène. Il aurait facilement pu se décrocher un poste au cégep
ou à l’université. Mais il a préféré s’ouvrir une boutique en ligne de vente de
t-shirts littéraires et de macarons.
La radicalité de ses choix de vie (il se plaint souvent de manquer
d’argent), contribue sans doute également à nourrir sa rage intérieure,
découlant intrinsèquement d’un constat déprimé sur la valeur de la littérature
québécoise dans un monde excité et souffrant de déficit de culture et
d’attention. Ses livres sont d’une violence inouïe, son jugement est
péremptoire et dévastateur et si ce qu’il écrit ne relève pas tout le temps
d’une posture nihiliste agressive, à tout le moins son discours n’entre pas
dans la catégorie des «feel
good novel».
En lisant LA VIE LITTÉRAIRE, je ne sais combien de cris, d’admonestations,
de remises en question vertigineuses, de claques en pleine face, de constats
nihilistes j’ai encaissés, ou devant combien de grands miroirs posés devant
notre ridicule croyance en notre importance biologique ai-je été prié de me
regarder. La lecture de ce livre agit comme un fouet. Nous constatons à quel
point la sclérose et la naïveté idiote dirigent nos vies, plongent tous nos
désirs légitimes dans un bain beige navrant.
C’est une narratrice qui prend la parole dans LA VIE LITTÉRAIRE, livre
construit un peu à la manière de ses deux précédents, par blocs de textes sans
ponctuation, serrés, avec italiques imposés sur la première phrase ou tronçon,
laissant comprendre que chacun de ces textes a sa logique interne, son unicité
et son indépendance. Considérant que Mathieu Arsenault a participé à plusieurs
lectures publiques et qu’il lit ses textes comme s’il s’agissait de poèmes
individuels, choisissant des extraits épars de son livre, les récitant avec cette
verve colérique ou ce ton punk ou vengeur qui s’adresserait à la société en
général puis au spectateur en particulier, je tends à considérer ses livres,
depuis le début, comme des livres de poésie en prose ou des essais de poésie en
prose.
Poésie d’ailleurs fort théâtrale, car deux metteurs en scène ont déjà monté
ses précédentes œuvres au théâtre La Chapelle et au théâtre Denise-Pelletier.
Maintenant est-ce qu’adopter une narratrice pour porte-parole est ici
significatif, change vraiment l’optique de la charge du livre ? Non. Avec
quelques ajustements mentaux (je suis trop habitué à entendre Mathieu Arsenault
en lecture publique) il est aisé de transposer le genre du narrateur. Mais ce
détail est peu important. Gars ou fille, homme ou femme peuvent indifféremment
emprunter la voix tonitruante et désespérée de celui ou celle qui parle. Parce
qu’ici il s’agit de paroles proférées, de vigueur intellectuelle secouée, de
lucidité qui tombe de la bouche comme un crachat.
Quand la narratrice dit : «et tous ces après-midi passés à me cultiver
n’ont jamais recelé aucunes tribulations rien ne se perd rien ne se trie tout
est un désordre d’informations les corps humains ne sont que des bandelettes
continues de détails épars sans rien au milieu», le ton est donné. Dans LA VIE
LITTÉRAIRE on parle de distances entre les désirs et la réalité, d’océans
d’informations qui nous stimulent tout en nous noyant, du désordre naturel de
la vie que l’on veut à tout pris contrôler avec nos moyens médiocres. À plusieurs reprises, la narratrice est
happée par l’insignifiance de ses prétentions littéraires, de la maigreur en
réalité de ses pauvres ambitions littéraires face à la cacophonie ambiante et à
la surexcitation permanente. Laisser une trace, oui, toujours et encore, laisser
une trace, pour le meilleur et pour le pire, et puis tant pis si c’est pour le
pire, l’important c’est de tout faire pour laisser une trace.
Ici encore : «dire qu’en réalité on passe nos journées assis à écrire
sans bouger sans parler étendre
les bras à la proue du titanic et crier vivre c’est poche écrire pour personne
c’est full hot et lire c’est mourir de lire c’est full fuck full fucking fuck
lol troll rofl truck pok». Arsenault, qu’on l’aime ou qu’il nous agace, a tout
de même réussi à saisir un état contemporain, une émotion dérangeante qui nous
a tous traversés. Il emprunte au vocabulaire hipster, à la culture populaire, à
l’histoire littéraire, à la sous-culture geek, dresse un portrait fort juste de
cette émotion complexe qui nous attache à l’époque actuelle tout en nous
dégoûtant de celle-ci. Parole décadente, télescope braquée sur la fin de
quelque chose en littérature, la fin de la grande époque de la grâce, la fin de
l’importance des intellectuels lyriques, sans aucun doute, mais la fin de quelque
chose de diffus. On ne sait pas trop ce qui se termine. Mais l’on sait que
beaucoup de choses n’existeront plus et nous sommes là, penaud, confus, en
attendant qu’on sache vraiment ce qui prendra fin en littérature grâce à la
technologie. Tout en défendant la démocratie d’internet et les copies d’œuvres
en tous genres à télécharger gratuitement partout. Personne ne sachant encore
comment résoudre cette quadrature du cercle.
Certes, il y a encore beaucoup d’énergie adolescente dans ce livre, une
espèce de colère pee-wee qui déborde sur la vie de tous les jours, englue les
perspectives et empêche à la narratrice d’aller voir plus loin que son nez, de
choisir d’agir plutôt que de subir la conjecture sociopolitique dans laquelle
elle patauge. Mais il s’agit de littérature, pas d’un discours politique. La
verdeur hirsute de Lautréamont et les jugements radicaux d’Holden Caulfield
gardent parfois cet aspect outrageusement adolescent. Je ne pense pas me
tromper en affirmant que Mathieu Arsenault est resté également un adulescent
modèle.
Livre à relire à haute voix, livre à décortiquer comme un essai sur la vie
littéraire d’aujourd’hui écrit sous la forme de plusieurs slams (même si le
personnage abhorre ce genre de spectacle littéraire), LA VIE LITTÉRAIRE est l’aboutissement,
selon moi, de cette prenante trilogie du CRI CONTEMPORAIN DE LA JEUNESSE (je la
nomme ainsi) de Mathieu Arsenault. Je ne doute pas qu’un autre metteur en scène
s’en empare.
Maintenant, allez goûter à
cette colère si la vie littéraire vous intéresse. Le buffet est vaste et vous y
trouverez sans doute votre compte. Il se peut même que vous souriiez. Parce
qu’entre nous, rien n’est plus drôle que tout ce cirque culturel qui entoure le
jeu du «laissage de trace».